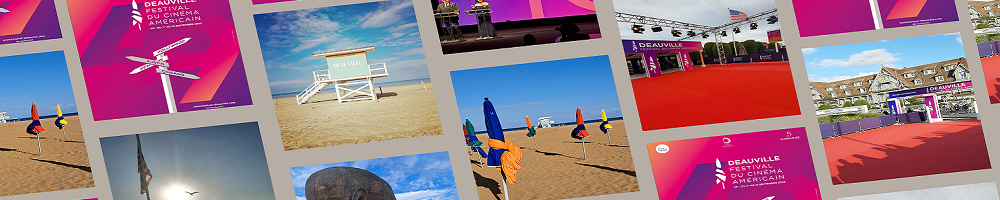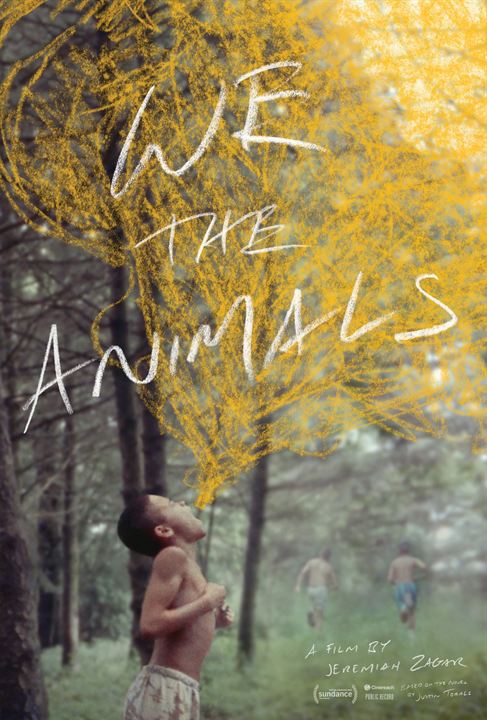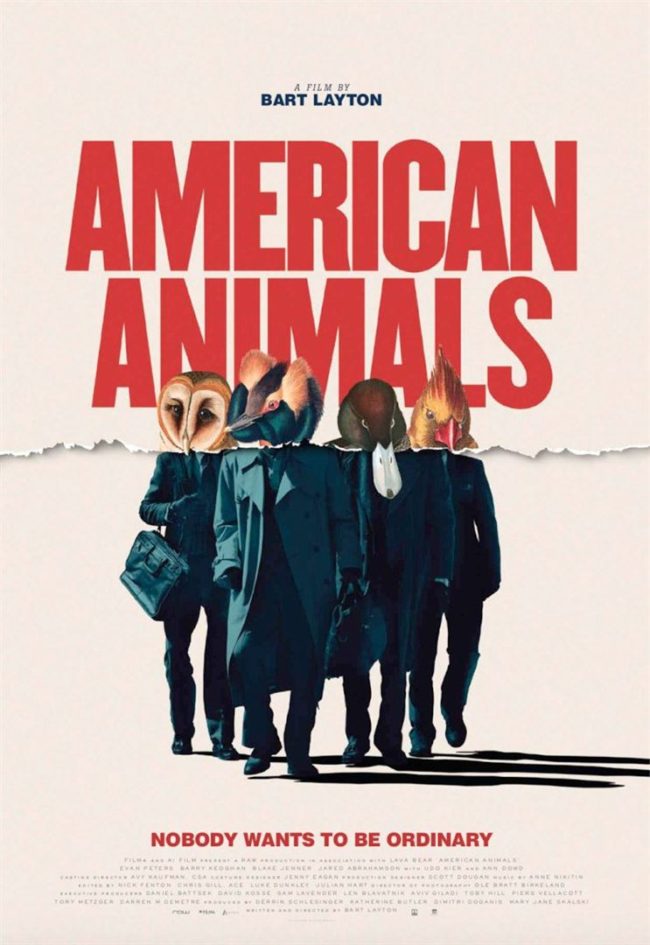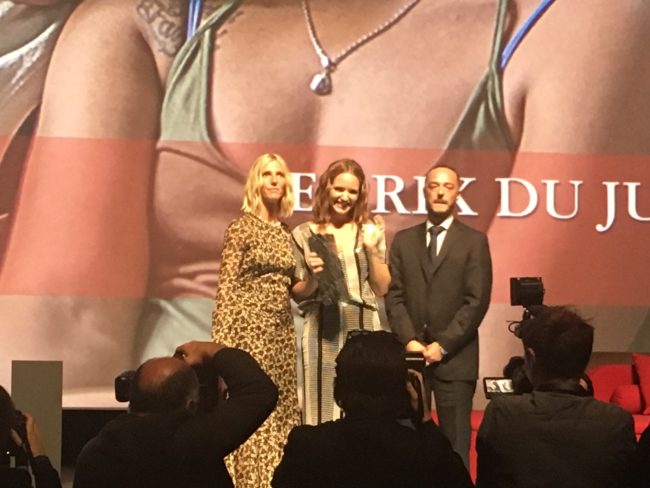Synopsis : Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce monde qui l'appelle ?
Leave No Trace est inspiré d’une histoire vraie. A Portland, une fille et son père ont été découverts alors qu’ils vivaient depuis 4 ans dans la réserve naturelle à la lisière la banlieue de la ville. Cette histoire vraie avait elle-même inspiré le roman de Peter Rock, L’Abandon, qui, fasciné par ce fait divers, a écrit un roman inspiré de celui-ci. Evidemment, ce nouveau long-métrage n’est pas sans rappeler l’univers de Winter’s Bone (également présenté en compétition à Deauville, en 2010, et qui reçut même une nomination aux Oscars pour le scénario), quête (initiatique et d’un père) d’une jeune fille au cœur d’une forêt isolée. On pense aussi bien sûr au Captain Fantastic de Matt Ross, également primé à Deauville, même si à la fantaisie de ce dernier Debra Granik a préféré le réalisme. On y retrouve le même combat entre une vie contemporaine et une vie plus "ancestrale" au contact de la nature. La jeune fille est écartelée entre son amour pour son père (traumatisé par son passé de militaire et incapable de s’adapter à une vie plus citadine) et cette envie d’une vie moins marginale. Le film est baigné d’une splendide lumière et du regard bienveillant que la réalisatrice porte sur ses personnages incarnés par deux comédiens exceptionnels : Ben Foster et une jeune actrice australienne, Thomasin McKenzie. Et là encore, après ce parcours initiatique, le personnage féminin décide courageusement de prendre son destin en main lors d’un dénouement sublime et poignant. Trois magnifiques personnages : un père et sa fille qui, chacun à leur manière, exercent leur liberté de penser et la nature, sublimée, à la fois hostile et protectrice. Une magnifique histoire d’amour entre un père et sa fille.