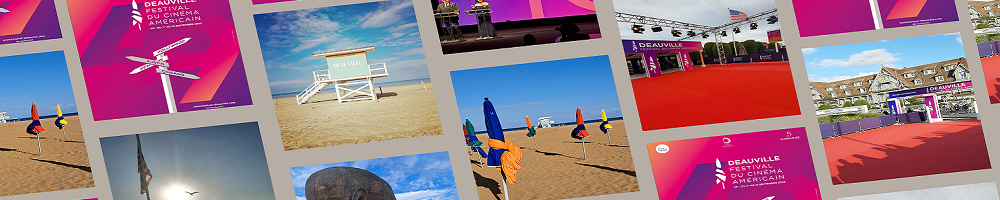La célébration du cinéma à Deauville : une fenêtre ouverte sur le monde, sur l’espoir et sur Cannes
Que serait le 7ème art sans salle de cinéma, projecteur de mystères qui en exalte la puissance évocatrice ? Des rêves bridés. Une fenêtre sur le monde entrebâillée. Une étreinte avec l'imaginaire bâclée. Cette édition, qui nous a permis de retrouver le frisson de la salle dans l’écrin du CID, était à l’image de ce film incontournable dans lequel figure sa Présidente du Jury, Vanessa Paradis, La fille sur le pont de Patrice Leconte. Un entrelacement subtil de gravité et légèreté.
« Le festival du cinéma américain devient le festival du cinéma tout court » a déclaré le Maire de Deauville lors de l’ouverture. Une édition « humble et généreuse » qui a en effet accueilli dix films du Festival de Cannes et trois du Festival du Film d’Animation d’Annecy. La « fenêtre ouverte sur le monde », pour la première fois depuis 1895, s'était refermée. Alors, le premier soir, c'est non sans émotion qu'elle s'est à nouveau ouverte. L’émotion de Michael Douglas lors de son discours (enregistré) pour l'hommage vibrant à son père Kirk. L’émotion provoquée par les notes d'Ennio Morricone interprétées au piano par Steve Nieve, suscitant les réminiscences de chefs-d’œuvre, eux, grâce à cela, immortels.
Au programme : secrets, solitudes, et maux (deuil, harcèlement) de personnages condamnés au silence, souvent englués dans des difficultés économiques les conduisant au bord du gouffre. En proie à des questionnements identitaires, aussi. Des films qui font voler les apparences en éclat. À l’image du savamment haletant et féroce The Nest de Sean Durkin (Grand Prix, Prix Roederer, Prix de la critique) qui, empruntant les codes du thriller, dissèque le délitement d’une famille causé par la soif de réussite sociale du père. La musique et la mise en scène, d’une élégante précision, épousent l’angoisse qui s’empare de chacun des membres de la famille, isolés dans leurs problèmes comme dans leur manoir britannique d’inspiration hitchcockienne. Noirceur et nuit s’emparent des âmes et des décors. Jusqu’à ce que le jour se lève et que le nid recueille ses occupants. Un scénario ciselé au service du suspense et d’un dénouement d’une logique à la fois surprenante et implacable.
Un autre film claquemurait ses protagonistes dans une situation inextricable : The Assistant de Kitty Green (Prix de la mise en scène). Au fil d’une journée, cette jeune diplômée engagée comme assistante d’un producteur de cinéma réalise à quel point il abuse de son pouvoir. Comme dans Les Ensorcelés de Minnelli projeté dans le cadre de l'hommage à Kirk Douglas, si le fond est une critique acerbe d’un milieu, la forme est un hommage au cinéma. Par l'utilisation judicieuse de toutes ses ressources. Les bureaux sont une sorte de dédale arachnéen, décor clinique dans les fils duquel elle semble prise et sous emprise, absurde comme dans un film de Tati auquel font penser l’utilisation du son, des silences et des espaces, oppressants. La réalisation apporte toute sa force à cette démonstration sans appel et nous invite, au contraire de l’assistante, abattue, à ne plus fermer les yeux.
Des films s’achevaient cependant par une lueur d’espoir. Nous laissant avec une image apaisante. La mer, souvent. Un départ salvateur. Une révolte. Comme le retentissant « non » du remarquable Slalom de Charlène Favier (prix d’Ornano-Valenti, label Cannes 2020). La réalisatrice s’est inspirée de sa propre vie pour raconter avec force et délicatesse l’emprise mentale et physique d’un entraîneur sur une jeune sportive (Noée Abita, époustouflante !). Un film percutant et nécessaire.
Parmi les autres films de la sélection Cannes 2020, Last words de Jonathan Nossiter. Juin 2086. Un homme déclare être le dernier humain sur la Terre qui n’est alors plus qu’un immense désert. Dans ce monde apocalyptique, le cinéma, ultime joie, devient plus « vivant » que la réalité, désormais un champ de ruines dénué de plaisirs et d’émotions, permettant à ceux qui y évoluent de redevenir des hommes dotés d’humanité. « Rêver la beauté du cinéma avant de mourir » y entend-on. De cette fable grinçante résultent la conscience accrue de la menace, imminente, et l’envie de s’abreuver plus que jamais à cette source de joie et de rires, bref d’émotions et de vie : le cinéma !
Dans Les deux Alfred de Bruno Podalydès (label Cannes 2020), là aussi il est question de déshumanisation d’un monde qui aurait encore pu être inventé par Jacques Tati : les mots (anglicismes, acronymes) et l’uberisation de la société font courir à l’égarement ceux qui s’y débattent. La première scène donne le ton de cette comédie : tendre, mordante, décalée, attachante, aux dialogues admirables. Un film porté par un trio d’acteurs désopilants, Sandrine Kiberlain en tête, qui donne envie de croquer la vie sur un air de Ferrat, et dans lequel la magie du cinéma nous fait croire qu’un slow peut surgir d’une voiture en pleine rue et rapprocher deux êtres en apparence si dissemblables. Une fantaisie réconfortante qui porte un regard à la fois doux et acéré sur les incongruités de notre société.
Même sans Américains et avec un seul hommage (à Barbet Schroeder) cette édition fut foisonnante. Il faudrait encore citer :
-Minari de Lee Isaac Chung, qui distille son charme dépourvu de cynisme en nous racontant le rêve américain d'une famille coréenne. Pour que leurs cœurs blessés guérissent, il faudra que tout s'embrase, réellement et symboliquement.
- Resistance de Jonathan Jakubowicz, sur le rôle du Mime Marceau pendant la Résistance qui, à 19 ans, contribua à sauver la vie de centaines d’enfants orphelins juifs.
-Sons of Philadelphia de Jérémie Guez, histoire de famille dans la mafia de Philadelphie, très influencée par Scorsese et James Gray, portée par un scénario brillamment retors.
-Kajillionaire de Miranda July, bijou d’inventivité et de burlesque, surprenant de la première à la dernière seconde.
-ADN de Maïwen : film choral qui oscille entre drame et comédie, sur la quête des origines, à voir pour Fanny Ardant, exceptionnelle en mère toxique et une scène de deuil, âprement drôle, d’une ravageuse clairvoyance.
Résultat : 38000 spectateurs malgré plus d'un tiers de sièges en moins ! Une esquisse de respiration pour le cinéma, en miroir de celle mise en scène par les films en compétition. Comme dans La fille sur le pont, encore :
« Peut-être qu’on a rêvé[...]et que c’était pas si mal » pouvait-on se dire au dénouement de ce festival. Alors si « L'art dérange comme les films de cette année » comme nous l’avait annoncé le Directeur du Festival Bruno Barde, il demeure aussi un générateur de rêves. Plus que jamais indispensable !